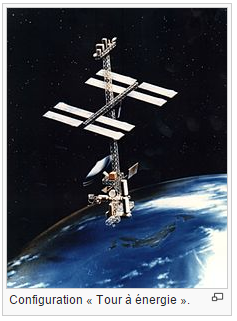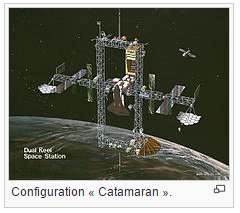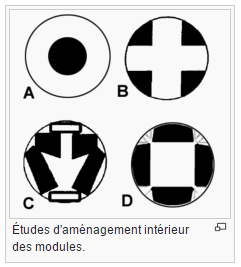La Station Spaciale
Internationale (ISS)



LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE
HISTORIQUE DE LA CONCEPTION DE LA STATION SPATIALE PAR LA NASA
L'architecture et l'aménagement intérieur de la partie non russe de la station spatiale
(~85 % du tonnage) sont l'aboutissement de longues études démarrées au début des
années 1970 qui ont abouti au cours des années 1980.
L'expérience de la station Skylab
La station Skylab (1973-1974) avait été réalisée en aménageant le troisième étage
d'une fusée Saturn V, haut de 39 mètreset de 7 mètres de diamètre, qui avait été
divisé dans le sens de la longueur en deux étages, fournissant ainsi un volume intérieur
de 480 m3. Bien que la station n'ait été habitée que brièvement (6 mois en temps
cumulé), ses occupants font des observations intéressantes qui seront prises en compte
dans la conception de la future station à laquelle certains d'entre eux vont d'ailleurs
participer. La NASA étudie au début des années 1970, sans avoir de vrai financement,
une station susceptible de succéder à Skylab. Après l'arrêt de la fabrication de
la fusée Saturn et le lancement du projet de navette spatiale, le concept de station
monolithique (un cylindre unique), à la manière de Skylab, est abandonné au profit
d'un ensemble de modules dont le diamètre est compatible avec la taille de la soute
de la navette (moins de 5 mètres). Le regroupement des modules autour d'un module
central servant de nœud est écarté car trop risqué. La NASA identifie à cette époque
la nécessité de disposer d'un vaisseau permettant d'évacuer à tout moment la station.
La configuration Tour à énergie
En 1982-1983 un groupe de travail de la NASA chargé de réfléchir au développement
d'une station spatiale, le Concept Development Group (CDG), met au point le concept
de « Tour à énergie » (Power tower) : une poutre verticale de près de100 mètres de
haut supporte à son sommet une poutre perpendiculaire de 75 mètres de long sur laquelle
sont répartis les panneaux solaires. Tous les autres composants sont attachés à l'extrémité
inférieure de la poutre et l'ensemble est stabilisé par gradient de gravité ce qui
permet de réduire le besoin de carburant pour contrôler l'orientation de la station.
La partie pressurisée, est constituée de quatre modules - deux laboratoires, un habitat
et un module de commandement - partageant la même architecture : un cylindre doté
d'un port d'amarrage à chaque extrémité et de quatre autres ports à sa périphérie
permettant de multiples arrangements. Pour l'aménagement intérieur, deux configurations
sont étudiées : un cloisonnement du cylindre en tranches à la manière de Skylab et
un aménagement longitudinal avec un plancher parallèle à la paroi du cylindre. Le
cloisonnement vertical génère des espaces confinés et peut créer des problèmes de
désorientation mais utilise mieux l'espace et fournit un bon accès au système de
support de vie.
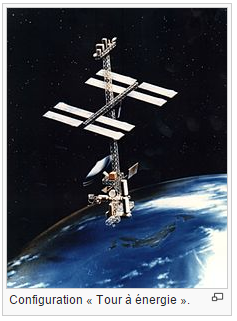
La configuration Catamaran
En 1985 la NASA entame, avec la participation de plusieurs industriels, la phase
B de son étude destinée à détailler les concepts déjà définis. Une étude plus fine
des besoins scientifiques - microgravité, observatoires céleste et terrestre - aboutit
à la disqualification du concept de « Tour à énergie » mal adapté. Une nouvelle architecture
dite Catamaran (Dual Keel) est mise au point : deux poutres verticales parallèles
supportent à leurs extrémités les télescopes spatiaux. Elles sont jointes en leur
centre par une longue poutre horizontale qui supporte en son milieu les modules pressurisés
et à ses extrémités les panneaux solaires.
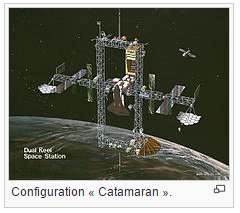
Aménagement intérieur
Parallèlement un groupe créé en 1983 au centre spatial Johnson se penche plus particulièrement
sur l'aménagement intérieur. Il s'agit à la fois de favoriser la productivité de
l'équipage par une optimisation de l'ergonomie et de permettre la mise à niveau de
la station et sa maintenance tout au long de sa durée de vie estimée à l'époque à 30 ans.
Pour parvenir à ce résultat les équipements intérieurs doivent être modulaires ;
la taille de chaque « meuble » doit être à la fois standardisée et suffisamment réduite
pour pouvoir passer par les écoutilles. Il est établi que la taille minimale compatible
avec la dimension des équipements usuels est celle d'un réfrigérateur. Par ailleurs
la disposition retenue doit permettre d'accéder facilement à la coque pressurisée
en cas de perforation. Plusieurs scénarios d'aménagement sont évalués : équipements
rassemblés autour de l'axe du module laissant un espace
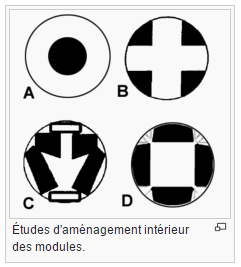
habitable entre ce noyau et la coque (Service Core A sur le schéma ci-contre). Mais
pour une coque de 4,5 mètres de diamètre, cette configuration laissait beaucoup moins
d'espace vital que celle consistant à rejeter les équipements le long de la coque.
Cette dernière disposition est donc retenue pour la suite de l'étude et à son tour
déclinée en plusieurs versions : une disposition avec les équipements placés aux
quatre angles laissant un volume libre en forme de croix (B) est éliminée car laissant
peu de place pour les équipements ; on écarte également un aménagement qui superpose
deux formats d'équipement de chaque côté de l'espace laissé libre avec des gaines
techniques courant au niveau du plancher et du plafond (C). La solution finalement
retenue consiste à placer des équipements au format parfaitement identique sur les
quatre côtés de l'espace central (D). Les espaces libres de forme triangulaire situés
entre les équipements et la coque sont utilisés pour faire passer les gaines techniques.
Du module universel au module spécialisé
Pour réduire les coûts, la NASA était partie du principe que tous les modules de
la station seraient identiques (configuration K sur le schéma ci-contre) ; l'ajout
d'équipements intérieurs spécialisés devait permettre de répondre aux besoins couverts
spécifiquement par chaque module. Mais les études plus détaillées montrèrent que,
compte tenu du nombre réduit de modules à produire, le gain financier espéré ne compensait
pas le surcroît de complexité et de masse d'un module « universel ». En particulier
un tiers du volume de chaque module devait être consacré aux six ports d'amarrage
radiaux et axiaux très volumineux et lourds compte tenu de leur

gabarit généreux. Aussi fut-il décidé que le module commun ne prendrait pas en charge
les fonctions de sas et de nœuds qui donneraient lieu au développement de modules
spécialisés. Dans cette nouvelle configuration le module commun, nettement allégé
car ne comportant plus que deux ouvertures aux extrémités du cylindre, pouvait être
allongé ce qui permettait de réduire le nombre de modules nécessaires ; les modules,
qui dans les configurations de l'époque assuraient des liaisons perpendiculaires
pour des raisons de sécurité (configuration « en carré »), pouvaient être abandonnés
au profit de simples tunnels pratiquement dépourvus d'équipements intérieurs et donc
très légers (L). Finalement il fut décidé d'allonger les modules de type nœud pour
qu'ils prennent en charge également la fonction des modules de liaison (configuration M puis
N). Le concept de module de liaison fut abandonné par la suite.
La coupole d'observation
Pour pouvoir travailler, il était nécessaire que l'équipage dispose d'une vue sur
l'extérieur : manœuvres d'amarrage et désamarrage des vaisseaux chargés du ravitaillement
et de la relève, intervention à distance sur la partie extérieure de la station grâces
aux bras robotisés, surveillance et maintenance. La réponse à ce besoin opposa d'une
part les partisans d'une vue « virtuelle » reconstituée sur les écrans d'un poste
de travail à partir d'images obtenues grâce à des caméras et d'autre part ceux qui,
au nom de la sécurité, exigeaient de disposer de hublots dans chaque module permettant
d'avoir une vue directe sur les composants de la station. Les détracteurs de cette
dernière solution soulignèrent que la présence de hublots fragilisait et alourdissait
la structure sans pour autant fournir une vue directe sur toutes les parties de la
station. La création de coupoles d'observation donnant une vision à 180° fut décidée
à l'issue de ces débats.